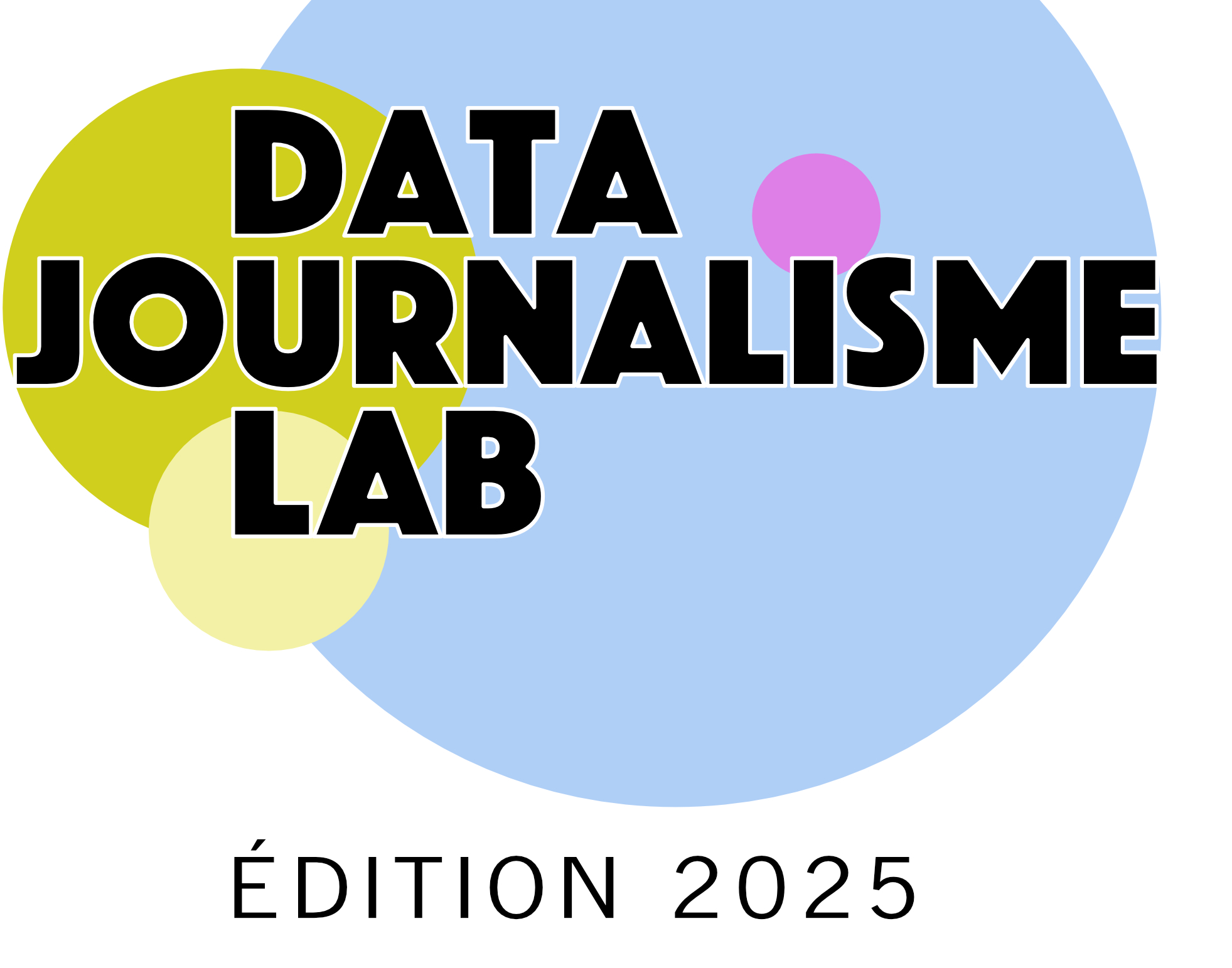Où est la petite balle jaune dans les quartiers défavorisés ? En 2019, le tennis représentait 2,9% des licences délivrées dans les zones prioritaires, c’est deux fois moins que le taux à l’échelle nationale. Entre le coût de la pratique, l’accessibilité aux terrains et l’image « élitiste ». La barrière est bien réelle.
« Quand ma génération est arrivée, il y a eu Jo (Tsonga), Gaël (Monfils) et moi. On pensait que les choses étaient en train de changer. C’est ce qu’on entendait dire autour de nous. Mais finalement, 15 ou 20 ans après, j’ai l’impression que ça n’a pas réellement bougé. »
Josselin Ouanna, ex 88ème joueur mondial en 2009, se désole du manque de diversité dans le tennis français. Lui, a été pris en charge par la Fédération française de tennis dès ses 9 ans. Il faisait partie des meilleurs de son année de naissance. Issu d’un milieu modeste, un père ouvrier et une mère maître-nageuse, Josselin n’aurait jamais pu prétendre à un accompagnement personnalisé hors de prix, financé par sa famille, pour intégrer l’ATP, le plus grand circuit mondial. Mais 20 ans après, Josselin Ouanna reste une exception.

En Gironde, département qui comporte le plus grand nombre de courts de tennis en France, comme dans de nombreux territoires français, la pratique du tennis reste marginale chez les jeunes issu·es des quartiers populaires. Cette sous- représentation interroge : est-elle le fruit d’une absence d’infrastructures dans ces quartiers, d’obstacles financiers, ou d’une image élitiste profondément ancrée ? Ou les trois à la fois ? Pour répondre à ces hypothèses, nous avons mené une enquête croisant témoignages d’acteur·ices de terrain, analyses sociologiques et données institutionnelles.
Le constat d’un fossé
Dans les « quartiers populaires », le sport peine à trouver sa place. Depuis 2015, l’État a regroupé sous une même appellation les zones les plus socialement fragiles : les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV). Dans le but de repérer ces zones pour réduire les inégalités territoriales, notamment en matière d’accès aux services publics, dont le sport. Dans ces zones, la pratique sportive fédérale reste bien en dessous de la moyenne nationale. En 2019, une étude portant sur 107 fédérations sportives révélait que seulement 4 % des licences sportives étaient détenues par des personnes résidant dans un QPV, alors
que les quartiers prioritaires représentent plus de 8 % de la population française totale en 2018. Gilles Vieille Marchiset, sociologue du sport et directeur du laboratoire « Sport et Sciences sociales » à Strasbourg, explique : « Dans les QPV, on observe une sous-pratique sportive marquée, avec peu de licenciés et un décrochage fort. »
Le tennis fait partie des disciplines les plus délaissées. Il représente 2,9 % des licences délivrées dans les QPV, contre 6,2 % à l’échelle du pays, selon l’institut national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire.
Le tennis souffre d’une image élitiste qui lui colle à la peau. Il est perçu comme technique, coûteux, socialement codé – autrement dit, éloigné des repères culturels et économiques des jeunes des QPV. Et les choix d’aménagement accentuent cette tendance : les collectivités privilégient la construction de stades de foot ou de dojos. Elles répondent à une demande massive, tout en excluant certaines disciplines.

Casser les codes bourgeois pour ouvrir le jeu
Comme tous les mercredis à Pessac, le quartier de Saige vibre au rythme des balles de tennis. Victor Chevallier donne les consignes et anime l’entraînement des enfants. Il est directeur de la branche Bordeaux-Gironde-Aquitaine de Fête le mur. Fondée par Yannick Noah en 1996, l’association souhaite démocratiser le tennis dans les quartiers populaires. Sa mission est avant tout sociale, comme l’explique Victor : « C’est une association socio-sportive d’éducation et d’insertion par le tennis. L’outil de rassemblement, c’est le sport. On cherche à créer des parcours, à débloquer des situations personnelles mais aussi professionnelles.” C’est le cas de Christopher qui découvert le tennis par le biais de l’association l’année dernière. Aujourd’hui, le jeune garçon de 16 ans aide Victor Chevallier dans l’encadrement des plus petit ·es. Il met de la voix et donne des conseils aux enfants. Si Christopher prend autant de plaisir, c’est parce qu’il a un objectif en tête : passer son BAFA.
Laila, sourire aux lèvres et raquette à la main, observe Abir, sa fille de 6 ans, s’amuser sur le terrain jonché de balles. « C’est une chance d’avoir l’association, confie-t-elle. J’ai commencé à jouer aussi pour partager des moments avec ma fille. Maintenant, quand je dis à mes copines que je fais du tennis, elles me disent que c’est la classe et que ça doit coûter une blinde ! ».
Une phrase qui n’a rien d’anodin pour Gilles Vieille Marchiset : « C’est le propre du culturel. Quels que soient les milieux, les pratiques sportives sont intériorisées et associées à des stéréotypes habituels, souvent malgré nous », analyse-t-il. Dans tout sport, le fait de s’identifier à des modèles issu·es des mêmes milieux joue un rôle déterminant. Si le football ne manque pas de figures issues des quartiers populaires, le tennis n’en propose que très peu. « Le tennis, c’est de l’entre-soi », commente le sociologue.
Mais les institutions du tennis français entendent-elles changer cet état de fait ? Dominique Decoux est vice-présidente de la Fédération française de tennis, chargée de l’intégrité, de l’inclusion, et de la responsabilité sociétale des organisations. Si elle refuse d’admettre que le tennis est un entre soi, elle conçoit que : « Les enfants de quartiers ont le sentiment que le tennis n’est pas un sport qui s’adresse à elleux. D’où l’intérêt d’une convention entre la Fédération et Fête le mur, qui a vraiment développé le tennis dans les quartiers. » Elle ajoute « après, il faut être conscient que dans les quartiers, notre concurrence, c’est le foot. Le tennis n’est pas un sport où on se retrouve en bas des tours pour jouer.»
Pour inciter les jeunes des quartiers défavorisés à se tourner davantage vers la petite balle jaune, la fédération cherche à innover grâce à de nouvelles pratiques : « Nous développons l’urban tennis. L’idée d’un tennis partout et pour tous. Grâce à ça, on casse la difficulté de rentrer dans un club. Il faut dessiner des terrains d’urban tennis dans des zones, dans des quartiers, des centres-villes.”
Si la FFT met en évidence son envie de propulser l’urban tennis, rien ne remplacera une pratique dans des conditions adéquates. Ce type d’initiative indique, en creux, l’absence d’équipements.
L’Urban Tennis, lancé par la Fédération Française de Tennis en 2022, vise à démocratiser ce sport en le rendant accessible à tous. Il se joue sur un terrain de 6×12 mètres, avec des raquettes de 21 pouces et une balle en mousse, et peut s’adapter à l’environnement urbain, en utilisant murs et murets comme éléments de jeu. Depuis 2022, la FFT installe des terrains permanents partout en France, notamment dans des collèges, des quartiers populaires ou même des établissements pénitentiaires. Pour l’instant, on dénombre 8 terrains dont 4 à Paris.
Quartiers populaires, un terrain défavorable : l’absence d’infrastructures
Pour pérenniser la pratique et recruter des jeunes joueur·euse·s, la question des infrastructures est centrale. La Gironde est le département le plus doté en courts de tennis avec 343 installations sportives composées d’un ou plusieurs terrains. Mais sont-elles bien réparties ?
54 % des terrains sont situés dans des zones où le niveau de vie annuel moyen est inférieur au niveau médian départemental (23 950 €). Un chiffre encourageant ? Pas tout à fait. Car aucune de ces infrastructures ne se situe dans une zone où le niveau de vie moyen se rapproche du seuil de pauvreté (14 598 €).
En Gironde, le court situé dans la zone la moins favorisée se trouve à Les Églisottes-et-Chalaures, où le niveau de vie moyen est de 18 604 €.
Autre critère à observer : la part des ménages pauvres, à proximité des terrains. Plus on est pauvre, moins on a de terrains. Sur les 343 installations, 129 sont localisées dans des zones où la part de ménages pauvres est supérieure au seuil départemental de 12,8%. Les 214 autres se trouvent dans des zones bien moins marquées par la pauvreté.
La présence ou non de logements sociaux près des terrains est également un critère intéressant. En Gironde, seules 25 installations sportives sont situées dans des zones où la part de logements sociaux est supérieure à 15%.
Mais la simple présence d’un terrain ou d’une installation n’est pas suffisante. Parmi les installations situées dans des zones où le niveau de vie annuel est inférieur au niveau médian départemental, 87% des terrains sont découverts. Un chiffre bien au-dessus des 66%, dans les zones à niveau de vie supérieur au niveau médian départemental. Ce manque de terrains couverts est un handicap, en cas de conditions météorologiques rendant la pratique sportive impossible. Certaines installations comprennent des terrains couverts et découverts. Cela offre une flexibilité plus grande aux pratiquant·es pour jouer. Dans les zones à niveau de vie inférieur, elles ne représentent que 10,3% des installations, là où, dans les zones plus aisées, le taux monte à 29,9%. Là encore, les zones les plus populaires bénéficient d’installations qui semblent moins conformes à une pratique adéquate du tennis.
Sur toute la Gironde, le peu de terrains en accès libre est également à considérer. Plus de 90% des 343 installations qui comportent au moins un terrain de tennis ne sont pas accessibles librement au public.
En résumé, même dans le département le mieux doté en courts de tennis, ces équipements restent implantés dans des zones plus aisées, et très peu sont accessibles dans les secteurs les plus défavorisés ou les quartiers à forte concentration de logements sociaux.
Des city stades plutôt que des courts de tennis ?
En périphérie de Bordeaux, Emmanuel Sagardoy, directeur sportif du C.A Lormont, en est convaincu : pour favoriser la pratique du tennis, il faut des terrains en accès libre.
Et selon lui, le problème ne vient pas de la demande. En milieu scolaire, il la constate : « J’amène des raquettes, des balles… Les enfants sont tous intéressés. Ils sont motivés pour essayer quelque chose de nouveau. »
Mais si l’intérêt des jeunes issu·es de QPV pour le tennis est bien là, il ne se traduit pas nécessairement par une inscription en club. L’engagement sur le long terme reste limité. Peu franchissent la porte des clubs, même lorsqu’ils se situent près de chez elleux. Emmanuel le constate à Lormont : « Aujourd’hui, à peine 10% de nos jeunes adhérents viennent des quartiers populaires ». Pour lui, c’est clair : sans impulsion publique, notamment de la mairie, rien ne changera.
À quelques kilomètres de là, à Cenon, la création de terrains de tennis en libre accès ne s’impose pas comme une priorité. Pour Philippe Escousse, directeur des sports de la ville, mener une politique sportive au niveau local exige de répondre à des contraintes à la fois budgétaires et stratégiques. Les courts de tennis coûtent plus cher à construire et à entretenir, contrairement à d’autres installations sportives. La mairie considère que la fréquentation du club de tennis n’est pas assez forte pour nécessiter la création d’un terrain en libre accès. « L’objectif est d’ouvrir prochainement deux city-stades car les clubs de foot sont saturés », justifie-t-il.
Le coût caché du tennis
Au-delà de la question des infrastructures, impossible de passer à côté du montant à dépenser pour jouer au tennis en club. Une barrière quasi impossible à franchir pour les personnes issues des quartiers populaires. Mais quand il faut aborder le sujet, tout le monde se renvoie la balle.
La fédération estime que le tennis est un sport accessible : « On est l’une des licences les moins chères ! La différence financière qu’il peut y avoir par rapport à d’autres disciplines est liée à l’adhésion au club.” La FFT assure qu’on peut jouer au tennis pour 80 euros l’année, licence comprise. « On crée des liens avec les collectivités locales et les clubs pour qu’il y ait des facilités financières si besoin”, ajoute Dominique Decoux.
Au cœur de l’élite du tennis bordelais au centre omnisport des Girondins, Florian Remond est le créateur du Centre de développement haut niveau (CDHN). Avec sa formule de coaching privé, il propose des prestations annuelles tout compris pour les jeunes aspirant·es à faire partie des meilleur·e·s joueur·euse·s français·es. Pourtant loin de l’image d’un tennis populaire, il comprend les difficultés mais relativise : « Les infrastructures sont là et ça ne coûte pas si cher de jouer au tennis. Il te faut une raquette et une paire de chaussures. C’est après, quand on commence à jouer à un bon niveau, que les coûts deviennent élevés. Et là, il y a une barrière oui.”
Les difficultés financières sont bien là. Et ce sont les concerné·es qui en parlent le mieux. Au milieu des tours du quartier de Saige, Laila déplore « C’est cher comme sport. Quand je vois les prix dans les clubs, j’hallucine ! Jamais je ne pourrais me le permettre. Se payer une raquette, des chaussures spéciales, ce n’est pas donné.” À Fête le Mur, Laila débourse une somme « symbolique”, entre 25 et 50 euros à l’année.
Victor Chevallier, directeur régional de l’association, approuve : « Une raquette, ce n’est pas le même prix qu’un ballon de foot. L’adhésion sportive n’est pas donnée pour une famille.” Le coach fait, encore une fois, le parallèle avec le foot, décidément dans toutes les têtes. « Au foot, tu ne payes pas le tournoi du samedi, alors qu’au tennis, tu dois rajouter, pour les moins chers, dix ou quinze euros par personne.”
S’équiper pour jouer au tennis constitue déjà un obstacle. Lorsqu’on souhaite progresser en classement, la barrière économique s’intensifie. Entre les frais d’inscription, de coaching individuel, de participation aux compétitions mais surtout de déplacement, la facture devient longue. Florian Remond, du CDHN, le souligne « Dès les U12 il y a un système de classement européen. Pour prétendre à ce classement là, il faut voyager. Et les voyages, c’est les parents et la famille qui payent l’intégralité. » C’est alors qu’un mur se dresse pour les jeunes issu·es de QPV. Et les rares aides fédérales sont réservées à une élite très restreinte. Florian Remond le confirme : « Si tu n’es pas dans les trois meilleurs Français de ton année, tu n’es pas aidé par la fédération. Zéro ». Le tennis est bel et bien un sport dont l’accès au haut niveau est conditionné par la capacité financière des familles.
Comment aller de l’avant ? Développer les compétitions locales, et ainsi limiter les coûts de déplacement ? Renforcer les passerelles entre système scolaire et milieu sportif ? Mettre en place davantage d’aides financières à destination des jeunes joueur·euse·s et de leurs familles ? Si tous plaident pour une démocratisation du tennis dans les quartiers populaires, la question porte plutôt sur la manière de le faire, et surtout, à qui incombe cette responsabilité.
La Fédération française de tennis est la fédération sportive la plus riche de France, notamment grâce aux bénéfices qu’engendre Roland Garros ou encore grâce à l’essor du padel. Mais, en off, certains acteurs regrettent un manque de continuité dans les politiques. La présidence a changé deux fois ces huit dernières années. Il faut désormais tracer les lignes d’une politique claire en matière d’inclusion des quartiers populaires dans le tennis. À ce moment-là, le·la prochain·e Français·e vainqueur·e d’un tournoi du Grand Chelem, tant attendu depuis Yannick Noah, sera peut-être originaire des quartiers populaires ?
Juliette Hirrien, Enzo Calderon, Louise Fornili, Sacha Gaudin, Pablo Perez et Emma Likaj