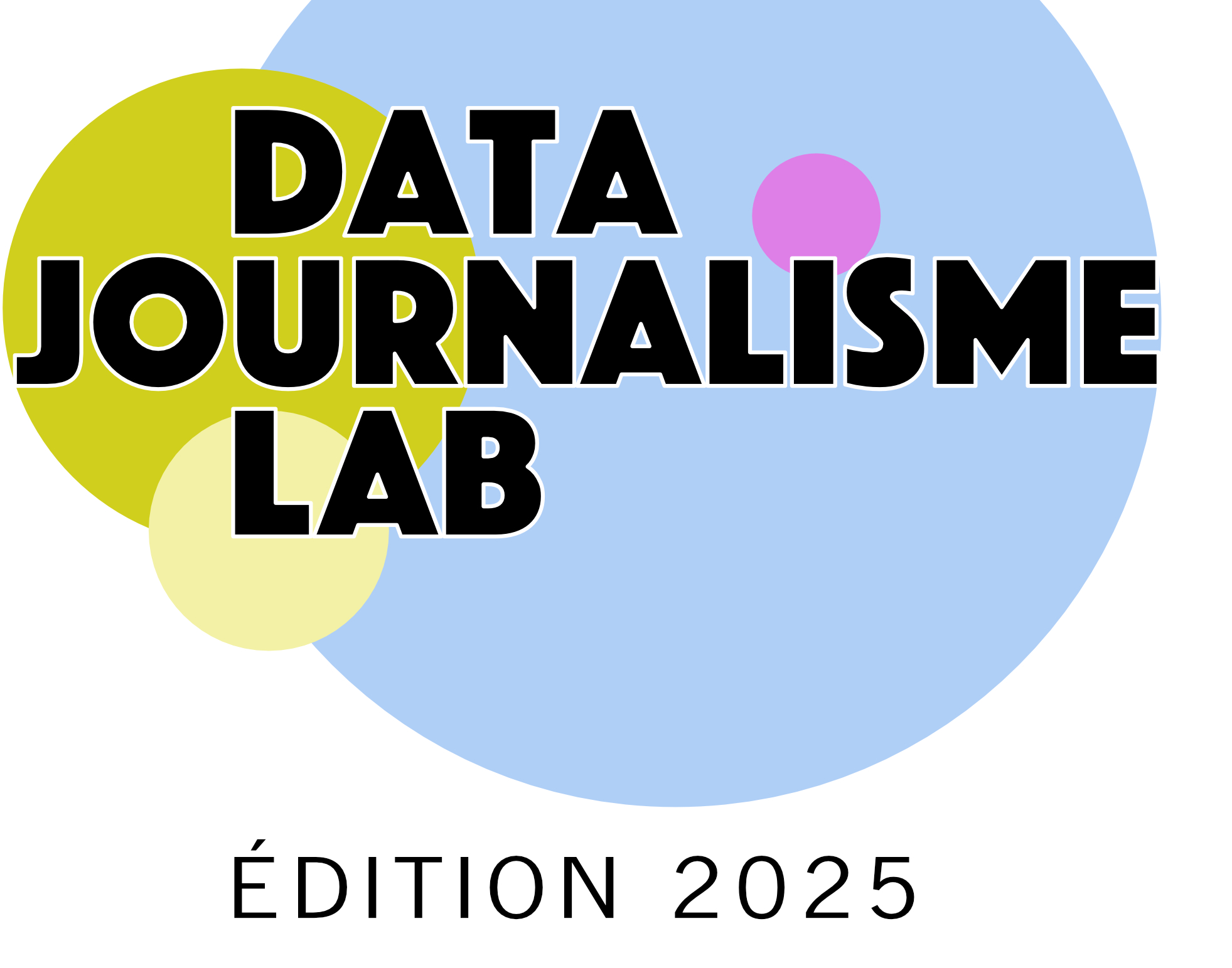À quoi ça tient, un sujet ? Vendredi après-midi, juste avant le début de cette semaine intensive de datajournalisme, nous avions rassemblé ressources, données et interlocuteurs pour construire une enquête sur l’accès aux soins en milieu carcéral. La vie est pleine de rebondissements. Lundi matin, présentation de notre base de données inexploitable et de notre angle branlant. Gros yeux des enseignants, réunion de crise. Lundi midi, nous n’avons plus ni sujet, ni énergie. On part manger. Au retour de pause, on écume data.gouv dans l’espoir de trouver une base de données déjà constituée qui nous semble intéressante. Banco ! Un fichier csv qui recense l’ensemble des décisions du Cneser entre 2008 et 2022 nous tend les bras.
Avis aux lecteurs et lectrices qui s’interrogent sur ce qu’est le Cneser : tout est expliqué dans notre article, on vous suggère de le lire avant. Ici, vous apprendrez juste comment nous avons travaillé.
Construire une enquête data, c’est pas facile
Étape I : Comprendre
Le groupe se scinde en deux : ceux qui savent lire un tableau de données, et les autres. Ces derniers se lancent dans la récolte de témoignages, les interviews d’experts et la lecture de textes juridiques pour comprendre ce qu’est le Cneser, et quelles sont les procédures disciplinaires au sein des universités. Présidences, syndicats étudiants, syndicats enseignants, avocats en droit public, juriste… on chalute les informations. Et on essaie vaille que vaille de tout mettre en commun, pour permettre une rédaction fluide. (L’étape trois montrera qu’on n’a pas vraiment réussi.)
Côté data, ça débroussaille ferme. Le jeu de données contient le détail des 1 288 décisions du Cneser entre 2008 et 2022, en fonction de 14 variables. Parmi elles, l’établissement où se sont déroulés les faits à l’origine de la procédure (fig.1 colonne E), le statut de la personne déférée (colonne F), le type de faits reprochés (colonne I), leur description (colonne J), le lien vers la publication du bulletin officiel portant mention de la décision (colonne L)…
Figure 1 : Jeu de données brut
On avale trois cafés, deux paquets de Haribos, un doliprane et on s’y remet.
S’approprier les données
En travaillant sur décisions du Cneser, on avait en tête de s’intéresser aux faits de violence des membres du corps enseignant au sein des universités. Selon la description du jeu de données sur data.gouv, les agissements qui mènent à une procédure disciplinaire au sein des universités sont catégorisés selon la nomenclature suivante :
Figure 2 : Capture d’écran de la nomenclature utilisée dans le jeu de données, telle que publiée sur data.gouv
Nous centrons tout d’abord notre analyse sur les catégories 1, 2, 3, 4 et 5 — pour lesquelles la notion de violence est explicite. Toutefois, en parcourant la description des faits reprochés, nous remarquons que les catégories 11 et 12 regroupent également des actes de violences. Résultat : nous nous penchons prioritairement sur les dossiers qui relèvent des nomenclatures 1, 2, 3, 4, 5, 11 et 12, soit 461 affaires.
Figure 3 : Tableur de travail sur le jeu de données
Certaines affaires regroupent des faits qui relèvent de plusieurs catégories. On compte l’apparition des catégories d’intérêt dans la colonne [faits_reproches_____voir_nomenclature_des_faits]
En bûchant sur le sujet, on remarque que certains médias pointent du doigt une certaine indulgence du Cneser vis-à-vis du personnel enseignant. On s’interroge sur la responsabilité des universités, puisque le seul cas de figure pour lequel un ou une déférée peut être sanctionné plus durement par le Cneser qu’en première instance, c’est lorsque l’université fait elle-même appel. (Encore une fois, si vous vous ne suivez plus, allez lire notre article. On a de très belles ✨ infographies ✨ .)
Problème : ce paramètre n’est pas précisé dans la base de données initiale. On doit donc récupérer cette information directement sur le site de chaque bulletin officiel. Or, comme ceux-ci sont hebdomadaires, un même bulletin contient plusieurs décisions.
Récupérer les informations
Trouver à la main, pour chaque décision, le numéro de dossier correspondant sur chaque bulletin officiel, pour ensuite rapporter dans notre tableur, toujours à la main, si le Cneser a été saisi par la personne déférée, son avocat ou l’université, nous prendrait trois semaines. On a deux jours. On automatise tout, grâce à un script en python disponible sur ce github. Malheureusement, tous les liens disponibles dans la base de données ne sont pas fonctionnels. Certains renvoient vers des pdf de l’AEF, le média à l’origine du fichier. On s’adapte, on solutionne, on met des exceptions, on finit par obtenir une valeur « origine de la demande », qui explicite pour chaque dossier qui a fait appel auprès du Cneser, et une autre « type d’appel », qui donne… eh bien, le type d’appel.
À noter que le Cneser peut statuer sur une demande de dépaysement (l’affaire est traitée dans une autre université que celle où se sont déroulés les faits), un désistement (la personne qui fait appel retire sa demande), le fonds de l’affaire (appel) ou en première instance (saisine directe, qui apparaît dans notre tableur comme « Problème »). On s’intéresse aussi aux appels incidents, c’est-à-dire aux appels interjetés par l’une des parties à l’affaire, alors que l’autre a déjà fait appel. À force de rustine et de try and except, avec beaucoup de vérifications manuelles, on obtient un jeu de données dont seuls 102 liens sur 1269 sont inexploitables. Sur ces 102 décisions, 42 seulement font partie de la nomenclature qui nous intéresse (1, 2, 3, 4, 5, 11 et 12). On aurait eu plus de temps, on les aurait fait à la main. Malheureusement, il est déjà midi. Mardi midi. Tic-tac.
Étape II : Faire des liens
On court toujours après des présidents d’université, des membres de commissions disciplinaires et le Graal : quelqu’un du Cneser. On veut aussi quantifier les affaires pour lesquelles le Cneser a appliqué une sanction moins sévère que la section disciplinaire, pour vérifier si l’instance est véritablement plus indulgente que les sections disciplinaires. Pauvres de nous ! Pas moyen d’automatiser cette classification, puisque les décisions rendues par chaque instance ne sont pas homogénéisées. En d’autres termes, le couple « Blâme PUIS exclusion (2 ans) » sera considéré comme différent de « Blâme PUIS deux ans d’exclusion ». Excel est stupide. Python est stupide. Nous sommes stupides. Pause café pour tout le monde. Stupide café.
De retour devant nos écrans, nous décidons de traiter à la main chacun des 1 055 couples uniques de décisions en première instance puis deuxième instance. Plusieurs possibilités : clémence, quand la décision du Cneser est moins sévère que la décision de première instance ; dureté, dans le cas contraire ; IDEM, lorsque les deux décisions sont strictement équivalentes ; non applicable, quand le Cneser n’a pas statué sur le fonds (demande de désistement, de dépaysement, de retrait d’appel…).
Figure 4 : Tableau de comparaison entre décisions de première et de deuxième instances
En réalisant ces comparaisons, toutefois, on se rend compte que certaines décisions de section disciplinaire très sévères sont remplacées par des peines plus légères par le Cneser, et inversement. Il faudrait donc, dans l’idéal, pouvoir donner une idée de l’écart qui existe entre les deux sanctions prononcées. Soupir généralisé. Ça ne s’arrêtera jamais.
Pause brownie.
Chercher la granularité
On bricole un indicateur de gravité des peines, basé sur la gradation fournie dans un article de l’AEF, présentée dans le tableau ci-dessous. Problème : certaines peines sont définies en fonction de leur durée d’application, critère que nous ne pouvons pas récupérer de manière automatique. Nous avons donc conçu notre propre échelle, basée sur les gradations prévues par les articles L952-8 et -9 du code de l’éducation.
| Gradation des peines – enseignants-chercheurs | Encodage pour les décisions de première instance | Encodage pour les décisions de deuxième instance |
| 0 : Relaxe | 0 : Relaxe ou sursis | |
| Blâme | 1 : Blâme | 1 : Blâme |
| Retard à l’avancement | 2 : Retard à l’avancement | 2 : Retard à l’avancement |
| Abaissement d’échelon | 5 : Abaissement d’échelon | 5 : Abaissement d’échelon |
| Interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans minimum | 6 : Interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs | 6 : Interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs |
| L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement | 7 : Interdiction d’enseigner dans l’établissement | 7 : Interdiction d’enseigner dans l’établissement |
| 8 : Interdiction d’enseigner dans tout établissement | 8 : Interdiction d’enseigner dans tout établissement | |
| Mise à la retraite d’office | 9 : Mise à la retraite d’office | 9 : Mise à la retraite d’office |
| Révocation | 10 : Révocation | 10 : Révocation |
| Gradation des peines – autres enseignants | Encodage pour les décisions de première instance | Encodage pour les décisions de deuxième instance |
| 0 : Relaxe | 0 : Relaxe ou sursis | |
| Rappel à l’ordre | 1 : Rappel à l’ordre ou blâme | 1 : Rappel à l’ordre ou blâme |
| Interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée maximum de deux ans | 2 : Interruption de fonctions dans l’établissement | 2 : Interruption de fonctions dans l’établissement |
| Exclusion de l’établissement | 3 : Exclusion de l’établissement | 5 : Exclusion de l’établissement |
| Interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement | 4 : Interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur | 6 : Interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur |
| 5 : Interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur | 7 : Interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur |
Pour ce qui est des étudiants, nous nous sommes basés sur l’échelle de sanctions disciplinaires telle que publiée dans l’article R811-36 du code de l’éducation.
| Gradation des peines – autres enseignants | Encodage pour les décisions de première instance | Encodage pour les décisions de deuxième instance |
| 0 : Relaxe ou acquittement ou non-lieu | 0 : Relaxe ou sursis | |
| Avertissement | 1 : Avertissement | 1 : Avertissement |
| Blâme | 2 : Blâme | 2 : Blâme |
| Mesure de responsabilisation | ||
| Exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans | 3 : Exclusion de l’établissement | 3 : Exclusion de l’établissement |
| Exclusion définitive de l’établissement | ||
| Exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans | 4 : Exclusion de tous les établissements | 4 : Exclusion de tous les établissements |
| Exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur | 5 : Exclusion définitive de tous les établissements | 5 : Exclusion définitive de tous les établissements |
Cet encodage des peines en valeur numérique comporte des lacunes : notre code ne permet pas de repérer les durées d’application — une interdiction d’enseigner de deux ans sera considérée comme l’équivalent d’une interdiction d’enseigner de six mois. Il permet toutefois de dégager des tendances, à la hausse ou à la baisse, en fonction des statuts. On commence à y voir plus clair.
Pause madeleine.
Incarner le sujet
Après une centaine de mails envoyés et une cinquantaine de coups de fil passés, on a réussi à obtenir les témoignages de quelques personnes. Environ ⅓ des bouteilles à la mer sont revenues à bon port. On passe la moitié de notre temps au téléphone, l’autre moitié à ingurgiter le plus d’informations possibles sur les réformes du Cneser, les affaires médiatisées d’enseignants chercheurs accusés d’agressions sexuelles et le fondement juridique des sanctions disciplinaires. Au menu :
- Tartines d’articles de France 3, France Info, Sud Ouest, 20 Minutes, France Bleu, DNA, Rue89 Strasbourg, Ouest France, Campus Matin
- Velouté de rapport de l’Observatoire des VSS, des Défenseurs des droits et de communiqués de presse de Clasches
- Purée de data.gouv, legifrance.gouv.
Il nous faut un temps off pour digérer. Petite pause café.gouv.
Étape III : Construire l’enquête
On a des témoignages, des tableaux dynamiques, des indicateurs, des avis d’experts, et on a du mal — c’est un euphémisme — à organiser le tout. Notre analyse de la gravité des sanctions nous permet de mettre en lumière une différence de traitement entre les membres du corps enseignant et du corps étudiant qui font appel au Cneser. Nous orientons donc notre enquête sur l’indulgence dont les enseignants bénéficient en appel, pour des faits de violences. Tous les témoignages récoltés valident les hypothèses que nous avons émises à partir des articles consultés et de nos données. Nous savons désormais que les enseignants avec un statut élevé au sein de l’université bénéficient plus souvent d’une sanction moins sévère en appel. Les rapports de force se retrouvent également au sein des affaires, avec des personnes déférées qui exercent une violence sur des victimes au statut hiérarchique inférieur. Nos nombreux appels et mails envoyés aux présidences et restés sans réponse confirment l’idée que le sujet reste encore très tabou dans l’enseignement supérieur. Mais pour en savoir plus, il faudrait que vous lisiez plutôt notre superbe enquête.
Quatrième étape : la rédaction
Il est maintenant temps de rédiger l’enquête. Objectif : une V1 pour jeudi 11h… Il est 22h (toujours jeudi). Entassés sur une petite table d’un café qui n’attend plus qu’on s’en aille pour fermer, on fait les transitions, on corrige les fautes, on se relit, on vérifie les mots. On paie son verre, et on change de bar. On se reconnecte au wifi et ça repart. Cinq Perrier citron plus tard, l’infographie est en bonne voie et le lissage des textes commence.
Vendredi matin : après 3 heures de sommeil, rendez-vous pour faire une dernière lecture tous ensemble.
Figure 5 : Nous, tard le soir
La recette pour réaliser une enquête data
Rassembler des témoignages
On remercie au générique :
- Nathalie Dompnier, ex-présidente de Lyon II
- Arturo, membre du syndicat étudiant du Poing Levé Bordeaux
- Anna, secrétaire générale de la FSE Bordeaux-Montaigne et du Poing Levé
- Lucas Marchand, professeur dans le secondaire et membre du syndicat des professeurs à la CGT
- Manon Moret, membre du bureau national de l’UNEF en charge de la gestion des VSS
- La cellule de signalement de l’université de Toulouse
- La CSTE de Mulhouse, syndicat étudiant
- Christophe Bonnet, membre du Cneser
- Pauline Gosset, doctorante qui travaille sur les procédures disciplinaires au sein des universités
- Source anciennement proche de la Présidence
- Giovanni Trouvé, juriste de l’Université Bordeaux Montaigne
Bûcher sur le sujet
- https://observatoire-vss.com/notre-barometre-national-2023-prepublication
- https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/Cneser-disciplinaire-plus-dun-tiers-des-enseignants-mis-en-cause-dans-des-affaires-de-vss-sont-relaxes/
- ://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2024-04/ddd_eclairages_denoncer-les-discriminations-vecues-a-l-universite_20240423.pdf
- https://www.20minutes.fr/societe/4061212-20231108-bordeaux-etudiants-denoncent-omerta-autour-violences-sexistes-sexuelles-universite-montaigne
- https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/universite-de-strasbourg-une-petition-contre-le-retour-d-un-professeur-accuse-d-agressions-sexuelles-et-sexistes-7293175
- https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2025/01/31/des-doctorantes-denoncent-des-faits-de-harcelement-psychologique-a-l-iphc
- https://www.rue89strasbourg.com/universite-de-strasbourg-harcelement-sexuel-alertes-archeologie-336633
- https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/rouen-les-syndicats-etudiants-reclament-la-transparence-apres-une-probable-tentative-de-suicide-sur-le-campus-pasteur-4200082
- https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haut-rhin/mulhouse/harcelement-sexuel-un-ex-enseignant-de-l-universite-de-haute-alsace-renvoye-devant-la-cour-d-appel-3122146.html
- https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/il-n-est-pas-le-bienvenu-ici-un-enseignant-accuse-de-harcelement-sexuel-de-retour-a-l-universite-des-etudiants-s-y-opposent-3079339.html
- https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haut-rhin/mulhouse/le-professeur-de-droit-condamne-pour-harcelement-sexuel-a-ete-revoque-par-l-universite-de-haute-alsace-2908034.html
- https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/harcelement-sexuel-un-professeur-decrit-comme-un-predateur-suspendu-a-l-universite-pantheon-assas_3407439.html
- https://www.ouest-france.fr/centre-val-de-loire/tours-37000/tours-le-president-de-l-universite-soupconne-de-harcelement-ete-place-en-garde-vue-6713951
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006193148/#LEGISCTA000006193148
- https://www.campusmatin.com/definition/Cneser.html
- https://clasches.fr/communique-de-presse-du-19-octobre-2022-la-deontologie-ca-nexiste-pas-le-Cneser-se-surpasse-et-relaxe/
Admettre ses limites
Notre travail sur la base de données du Cneser admet de grosses, très grosses limites. Nous aurions dû prendre davantage le temps de vérifier l’exactitude des données récupérées grâce au scraping, et exclure dès le début de notre analyse les affaires pour lesquelles les liens n’étaient pas exploitables. De même, certains doublons nous ont forcé à retirer des affaires de nos calculs. Or, étant donné que plusieurs personnes travaillaient en même temps sur le tableur, les choix de filtre n’ont pas nécessairement été uniformisés. Cet aspect de notre analyse manque de rigueur.
Chronologie de notre travail
Louise Jouveshomme et Mélanie Bourinet