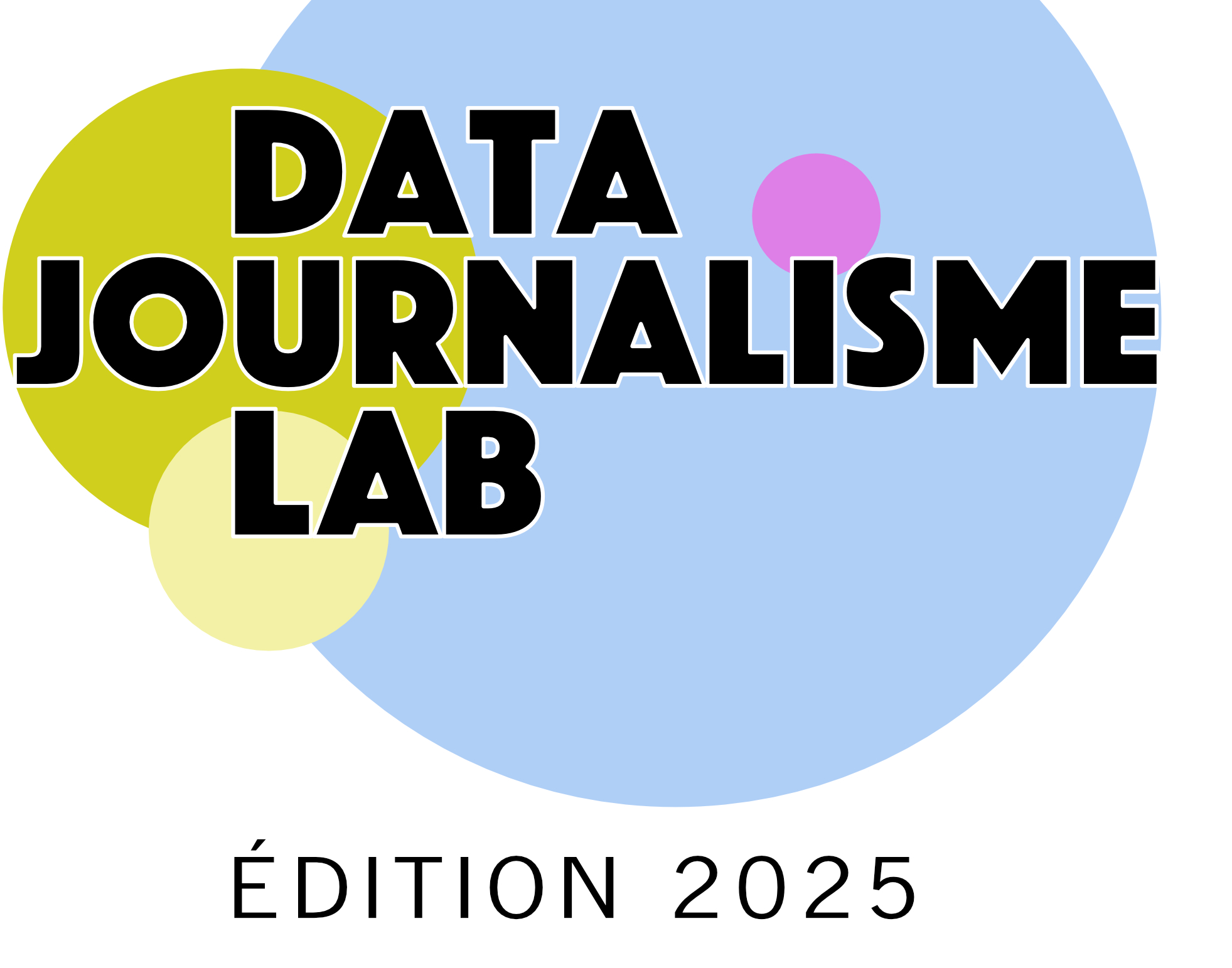Entre arrachage de vignes, dérèglement climatique et tensions commerciales, la Gironde traverse actuellement une crise agricole sans précédent. Subventions et labels aident, tant bien que mal, les agriculteurs à tenir la barque. Malgré des contraintes administratives et économiques, certains viticulteurs tentent de réinventer leurs pratiques.
« Vous avez de la chance, vous arrivez avant la pluie », lance Benoît Grelier, en observant le ciel assombri au-dessus de ses vignes, à Lapouyade, dans le nord de la Gironde. Depuis plus de vingt ans, ce viticulteur cultive 16 hectares de vignes en agriculture biologique, sans pesticides de synthèse. Mais il ne s’est pas arrêté là : en 2008, il a commencé à planter des arbres au cœur même de ses parcelles. Aujourd’hui, son domaine compte 1 000 arbres intra-parcellaires et 700 fruitiers, qui favorisent la biodiversité dans les sols. « On a voulu expérimenter des pratiques agroécologiques dès le départ. Restaurer les sols, adapter la vigne au changement climatique, favoriser les équilibres naturels… ça fait partie de notre démarche. »
Le domaine est désormais un terrain d’expérimentation, créé en partenariat avec l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement). Le prochain projet est déjà en cours : la mise en place d’un système agroforestier complet intégrant haies, étang et une diversité de plantations, sur une parcelle isolée du reste du domaine. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de Néo Terra, la feuille de route de la région Nouvelle-Aquitaine pour accompagner les transitions agricoles, climatiques et énergétiques. Des orientations qui concernent en premier lieu les viticulteurs, majoritaires parmi les exploitants du département.
Mais la participation à ces initiatives cache certaines difficultés. Pour bénéficier des aides régionales, Benoît Grelier a répondu à un appel d’offres et constitué un dossier, un processus long et laborieux.
Un système d’aides plus favorable aux grandes exploitations
Sa situation est loin d’être isolée. Depuis 1992, la Politique Agricole Commune (PAC), principal levier de financement de l’agriculture à l’échelle européenne, a intégré des objectifs environnementaux. Certaines aides sont désormais conditionnées à des pratiques plus durables, comme la diversification des cultures, le maintien de haies ou la limitation des intrants chimiques. Ces dispositifs, appelés éco-conditionnalités, MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques) ou plus récemment éco-régimes, représentent aujourd’hui environ 30 % des aides versées.
Mais selon Eudes Girard, professeur agrégé de géographie, les petites exploitations sont désavantagées. « La logique reste très largement productiviste. Ce sont les grandes exploitations, souvent céréalières, qui captent la majorité des aides. Les petites structures, elles, doivent financer d’abord, attendre ensuite, ce qui est difficile sans trésorerie. »
Lire notre enquête : « En Nouvelle-Aquitaine, les agriculteurs appellent aux aides »
Des labels environnementaux peu lisibles et peu valorisés
Au-delà des subventions, plusieurs labels environnementaux ont été développés pour encourager les exploitants à rejoindre la dynamique de transition écologique. Le plus courant aujourd’hui en viticulture est le label HVE, pour Haute Valeur Environnementale. Il est censé garantir le respect de certains critères comme la biodiversité, la gestion optimale de l’eau ou la réduction des intrants. Pour le géographe, ce label est, souvent, trop permissif : « On peut parfois l’obtenir en remplissant un seul critère. Et l’usage de certains herbicides, comme le glyphosate, n’est pas interdit. »
À l’inverse, le label AB (Agriculture Biologique) repose sur des règles strictes, notamment l’interdiction totale des produits chimiques de synthèse et des contrôles réguliers : une démarche coûteuse et exigeante pour les exploitants, qui concerne plus de 17 % des viticulteurs dans le département. À noter : après une hausse des projets bio avant 2020, la situation est inédite en 2024 : le nombre d’exploitations labellisées a baissé de 1,13 % dans le département.
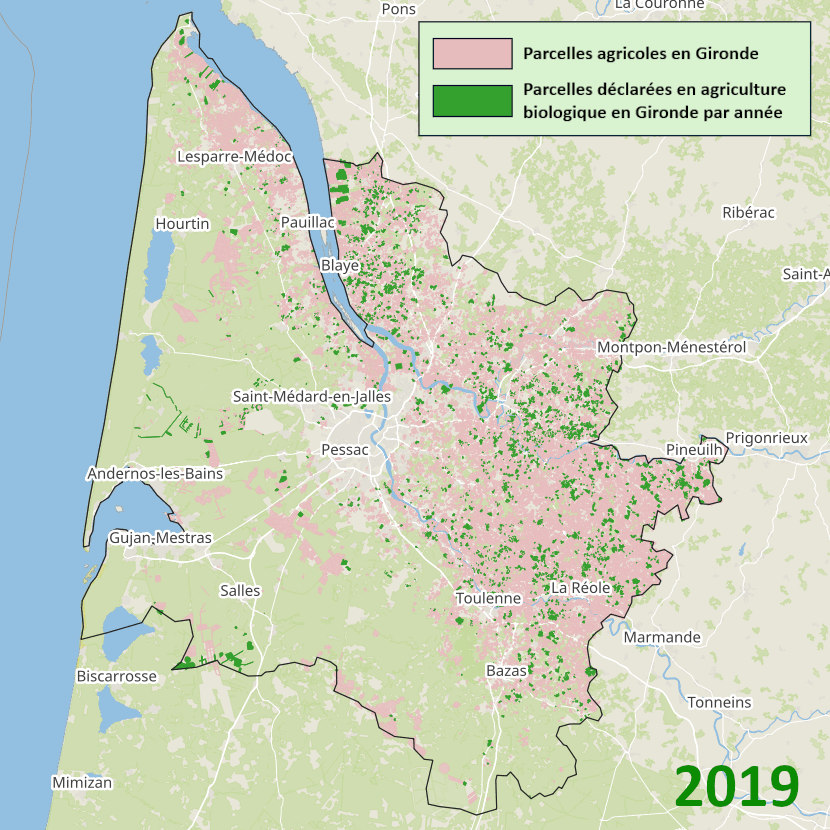
L’évolution des parcelles bio reste uniforme sur le territoire agricole girondin de 2019 à 2023.
En 2024, le bio n’occupe que 14 % de la surface agricole girondine
Source : Draaf, Agreste ©Yohan Dos santos Fernandes
D’autant que le marché du bio s’est également ralenti, après un pic pendant la crise Covid. En cause : la baisse du pouvoir d’achat, la concurrence des produits importés et une revalorisation incertaine des produits labellisés : « Mes prix restent équivalents au non-bio », précise le viticulteur Lapouyadais.
Lire notre enquête : « Agriculture bio : les labels se font la belle »
Une transition freinée par des déséquilibres persistants
En Gironde, une tendance claire se dessine : malgré les efforts consentis par les exploitants, le cadre structurel reste peu favorable aux plus petits. Qu’il s’agisse de subventions, de certifications ou de commercialisation, les freins sont nombreux.
Entre ambitions de durabilité, complexité des dispositifs, marché instable et inégalités d’accès aux aides, une question se pose : peut-on réellement verdir l’agriculture sans adapter en profondeur les mécanismes de soutien ?
C’est ce que ce dossier s’attache à explorer, à travers une enquête de terrain, des témoignages d’agriculteurs girondins et une analyse des politiques agricoles à l’échelle locale et nationale.
Un dossier d’enquête par Alyssa Appino, Alix Villeroy, Yohan Dos santos Fernandes, Clément Haritzhandiet, David Sani, Maël Brehonnet